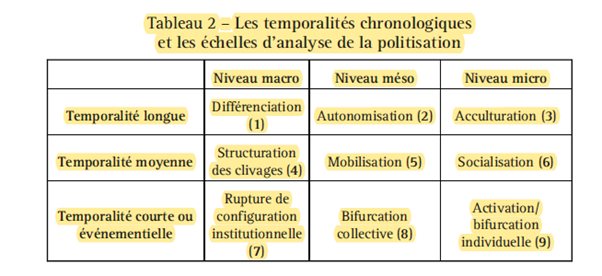En s'appuyant sur une recherche en cours, le séminaire de Léna Silberzahn s’intéresse aux émotions et affects au temps des crises écologiques.
Il est devenu courant de fustiger les « passions tristes » de l’écologie, sous prétexte qu’elles rendent cyniques ou apathiques ou qu’elles laissent entrevoir la possibilité de politiques manipulatrices et autoritaires. Effectivement, l’opposition entre « passions tristes » et liberté est un lieu commun pour nombre de théoricien‧ne·s du politique, tout comme la relation étroite entretenue entre ces affects et les dérives autoritaires et/ou réactionnaires. Au vu de la multiplication des crises, notamment écologiques, la question se pose de savoir comment faire de la politique à « l’ombre des catastrophes » sans glisser vers une posture autoritaire.
Si la théorie politique étudie depuis longtemps la question des affects en politique, ses concepts semblent inadaptés pour décrire et expliquer la peur, la colère, ou encore le chagrin lié à l’état actuel du monde. Basée sur une lecture de l’Anthropocène comme âge des passions tristes, cette recherche s’intéresse aux implications et aux modalités d’un agir politique à l’ombre des catastrophes. Avec l’aide de travaux féministes, de théories critiques et d’exemples issus de mobilisations présentes et passées, nous chercherons à esquisser les contours d’une politique des affects qui serait, non pas manipulatrice et excluante, mais mobilisatrice et émancipatrice.
Plutôt que de réduire l’enjeu climatique à une question de psychologie individuelle, ce travail s’inscrit dans l’effort contemporain de compréhension du rôle des procédures extra-argumentatives dans les processus de mobilisation et d’action collective. L’enjeu pour ces mobilisations est d’agréger et d’agencer différemment les affects afin de révéler leur puissance critique et politique.
Contexte : Comment dire et être affecté·e par le désastre en cours ?
Depuis le XVIIIe siècle, une majorité de mobilisations européennes se sont appuyées sur le récit utopique de la puissance humaine, capable de façonner son propre monde. Aujourd’hui, nous nous confrontons aux limites de ce récit. « L’âge de l’homme » — l’anthropocène — est aussi l’âge où la prodigieuse puissance de « l’homme » se retourne contre lui. « Société du risque », « catastrophe », « effondrement », « écologie de la dévastation » sont autant de tentatives de caractériser cette rupture, et la perte de capacité d’agir quelle entraine. Si ces glissements paradigmatiques ont été maintes fois commentés et étudiés, et que le recours à l’apocalyptique dans les discours écologistes fait lentement son entrée dans les objets des sciences humaines, les logiques affectives de ces différentes grammaires sont restées dans l’ombre.
Pourtant, les « passions tristes » (au sens d’affections du corps par lesquelles la puissance d’agir de ce corps est diminuée) propres à la dévastation écologique se multiplient, et façonnent nos manières d’agir. La peur est souvent citée en premier parmi les passions tristes écologistes. Les angoisses liées à la destruction néolibérale des mécanismes de solidarité et du lien social se doublent de la crainte chronique de menaces techniques et de catastrophes écologiques (cf. l’engouement médiatique autour de la notion d’« écoanxiété »).
Notre époque est également un âge de regrets et de pertes, où se multiplient les deuils, qu’ils soient réels, abstraits ou anticipés. Glenn Albrecht appelle solastalgie la « douleur chronique, liée à l’érosion progressive de l’identité et du sentiment d’appartenance à un lieu aimé particulier ; un sentiment de détresse, et de désolation psychologique, face à sa transformation non désirée
[1] ». On peut aussi faire une lecture de notre époque comme âge de la honte. Que ce soit à cause des modes de déplacement, de l’habitat ou de l’alimentation, il est impossible de mener une vie éthique au sein des systèmes économiques des pays dits développés. Le citoyen moyen européen contribue quasi inévitablement au désastre en cours, même s’il se dit écologiste et que sa part de responsabilité réelle est minime par rapport à celles de certains acteurs capitalistes. On pourrait multiplier les termes et les néologismes pour décrire affectivement notre présent politique, mais intéressons-nous désormais aux implications politiques de ce constat affectif.
I. Approches existantes : psychologisation et pathologisation
1. L’approche dépolitisante de la psychologie du climat (éviction du politique)
Qui s’intéresse à ces questions ne peut ignorer le corpus grandissant de travaux en psychologie du climat. Des chercheurs comme Robert Gifford ou Anthony Leiserowitz étudient depuis une vingtaine d’années les « dragons de l’inaction » pour déterminer les obstacles à un engagement écologiste [2] et l’association américaine de psychologie a déjà publié trois rapports tentant d’identifier les leviers et les freins aux comportements pro-environnementaux. « L’obstacle le plus important, s’agissant de traiter des perturbations climatiques, repose entre vos oreilles », concluait Per Espen Stoknes dans un Ted Talk visionné trois millions de fois. Très individualiste, la psychologie du climat est nécessairement limitée et pose un certain nombre de problèmes :
- Sur le plan épistémologique, les différences sociales et culturelles sont négligées. La psychologie du climat utilise des phénomènes psychologiques pour expliquer des phénomènes sociaux or il est certainement préférable de faire l’inverse.
- Sur le plan politique, cette démarche semble inopérante. Il s’agit d’une approche thérapeutique dont l’objectif est de faire du bien aux individus et non de s’attaquer aux racines du mal.
Comme le note Jean Baptiste Comby, la psychologisation des questions climatiques va souvent de pair avec leur dépolitisation.
2. L’approche désincarnée des sciences politiques (éviction et pathologisation de l’émotionnel)
Il est donc nécessaire de combiner cette étude avec des écrits plus politiques. Pourtant, nous nous heurtons ici à un problème inhérent aux sciences politiques, à savoir une oblitération des émotions et affects. Cela tient d’une part à des raisons historiques : la science politique s’est construite en France contre d’autres disciplines, telles que la psychanalyse notamment, et à partir d’héritages positivistes ; d’autre part, comme de nombreuses chercheuses féministes l’ont souligné, les sciences modernes reposent sur une conception de l’émotion comme une perturbation de l’âme et du corps, opposée binairement à la raison (et donc au politique). Les questions affectives sont évincées hors du politique, et donc de ses analyses.
Ce diagnostic doit être relativisé par l’important regain d’intérêt pour la question des affects depuis 1980 : on parle de tournant affectif (ou émotionnel) des sciences sociales. S’appuyant notamment sur des travaux en sciences cognitives et un nouvel engouement pour Spinoza, les sciences sociales s’intéressent aux affects pour mieux décrire les humains et les mouvements sociaux. Ces ambitions épistémologiques se doublent d’une réhabilitation normative de l’affect en politique : « Les affects ne sont pas une perturbation émotionnelle des facultés supérieures : ils sont ce par quoi un esprit, comme dans son ordre propre un corps, se met en mouvement et pense
[3] », résume F. Lordon.
Cependant, les affects dits « négatifs », en particulier la peur, la colère ou le désespoir, restent pathologisés, même parmi les penseur‧euse·s qui soutiennent qu’être affecté·e est une condition inhérente à l’existence humaine. S'appuyant sur la célèbre distinction de Spinoza entre les passions « joyeuses » et « tristes », certaines études ont contribué à rigidifier et à essentialiser cette distinction, célébrant les premières tout en pathologisant les secondes. Elles sont systématiquement dépeintes comme des dispositifs antidémocratiques, inefficaces, manipulateurs et paralysants.
Dans un contexte de renforcement autoritaire des dispositifs sécuritaires étatiques, plusieurs ouvrages récents ont à juste titre analysé comment certain‧e·s acteur‧ice·s, et notamment des États puissants, font (feront) de l’orchestration des inquiétudes et angoisses des citoyen‧ne·s (écologiques et autres) une politique pour dresser le corps social. Les affects, et notamment ceux résultants des « catastrophes » effectives et annoncées, sont analysés comme un levier de pouvoir instrumentalisé par les dominants dans le cadre d’une « biopolitique des catastrophes
[4] » ou d’une « administration du désastre
[5] ».
Certes, la circulation de peurs fictives et réelles favorise le déplacement de l’attention sur des exo-groupes. Leur incrimination permet de détourner des problèmes systémiques plus profonds, et de justifier des opérations de contrôle social. Certains partis d’extrême droite ont d’ailleurs compris depuis longtemps que notre ère venait avec son lot d’émotions négatives et de peurs à l’égard du futur, de la finitude des ressources ou des migrations. Ils adressent, attisent et instrumentalisent ces affects frontalement, notamment en désignant des boucs émissaires, et en invoquant des fantasmes d’un passé glorieux : des solastalgies réactionnaires en quelques sortes.
Il ne faudrait pas ôter à ces diagnostics leur valeur, dans le sens où le phénomène de « politique de la peur » n’est pas fantasmé. Néanmoins, la question est traitée de manière unilatérale. Peut-on imaginer une politique des passions tristes émancipatrice, au-delà de l’apathie et de l’obéissance aveugle que nous prédisent les théories du politique ?
II. De l’affect au pouvoir d’être affecté
1. Heuristiques de la peur : une revalorisation épistémologique et morale
Hans Jonas et Günther Anders sont souvent cités lorsqu’il s’agit de réhabiliter la peur comme sentiment moral et rationnel en contexte de menaces techniques et de destructions environnementales. À une époque où la science n’est plus en mesure d’aiguiller l’agir humain, les émotions pallient les limites de la raison : « Il est beaucoup plus probable que la peur obtienne ce que la raison n’a pas obtenu
[6] », écrit Jonas. De même, Günther Anders estime que notre incapacité à imaginer et à nous figurer émotionnellement les conséquences de nos productions techniques (le « décalage prométhéen » entre notre production et notre imagination) mène à une cécité face à l’apocalypse : « Nous pouvons assassiner des milliers de personnes, nous représenter peut-être une dizaine de morts ; mais tout au plus, pleurer ou nous repentir d’en avoir tué un seul
[7] ». Chez Anders et Jonas, les affections et émotions deviennent une
boussole qui nous indique ce à quoi nous tenons.
Pourtant, si les philosophes proposent une revalorisation épistémologique et morale des « passions tristes », et notamment de la peur, qui devient disposition nécessaire à toute action morale, la question de la traduction politique reste ouverte (mises à part quelques déclarations ambiguës, et de caractère autoritaire, de la part de Hans Jonas notamment, sur la désirabilité d’une tyrannie bienveillante). Que faire lorsque la peur de la catastrophe mène à un état de sidération ? Comment faire naître cette peur morale (et pas une autre) ? Qui fait naître cette peur ? Jonas et Anders nous permettent de saisir la valeur éthique et morale de la peur, mais pas sa valeur politique.
2. Les critiques féministes du bonheur : émancipation politique et passions tristes
Les approches féministes permettent de comprendre la valeur épistémologique des passions avec, cette fois, une approche politique. On trouve dans les écrits féministes une longue tradition de réfutation des récits progressistes par la valorisation politique des affects dits négatifs dans les processus de changement social.
Dans La promesse du bonheur, la chercheuse Sara Ahmed examine d'un œil critique notre obsession occidentale pour le bonheur qui tait et invisibilise "les féministes rabat joies", "les femmes noires en colère", "les migrants mélancoliques". Dans un contexte où l’injonction au bonheur sert le maintien du statut quo sociétal, accepter de "tuer la joie" revient à « faire de la place pour la vie, faire de la place pour le possible[8] ». Similairement, Lauren Berlant voit en notre optimisme une certaine cruauté[9]. Elle explique que notre optimisme compulsif s’est transformé en « optimisme cruel », qui attache les gens à des fantasmes, promesses ou des choses qui menacent en fait leur bien-être. On pourrait multiplier les exemples. Il existe toute une tradition de travaux féministes qui fait des « passions tristes » un pilier du changement social.
Cette revalorisation n’est pas simplement théorique, ou morale, mais elle se fait également dans la pratique. Les mobilisations féministes et écoféministes mettent en avant des manières différentes d’être affecté·e par le monde, et inscrivent ces affections au cœur de leur pratiques. On peut citer notamment les groupes de
consciousness raising [sensibilisation] formés par des femmes à travers les États-Unis pour discuter de leurs expériences quotidiennes du patriarcat pour s'en libérer. En discutant de la douleur et des luttes de leur vie quotidienne, les femmes participant à ces cercles ont transformé des questions considérées comme des "problèmes individuels" en problèmes politiques
[10]. On peut également citer les
Women’s Pentagon Actions [Les manifestations des femmes au Pentagone] (1980 et 1981) contre la course à l’armement nucléaire à l’issue de la conférence
« Women and Life on Earth [Femmes et Vie sur Terre] ».
Dans ces deux exemples, le début de la mobilisation se construit sur une légitimation de l’expression des ressentis. Le partage et la validation de certaines émotions, considérées par le reste de la société comme illégitimes; devient la base d’une sous-culture définie par des perceptions et des valeurs qui s’opposent à celles dominantes. Ces communautés mettent en avant une épistémologie alternative. Les sentiments, et surtout les sentiments négatifs, sont un point de départ pour l'analyse politique systémique (voir le « Unity statement [Déclaration unitaire] » de l’action du Pentagone, voir aussi « Our politics begin with our feelings [Notre politique commence avec nos sentiments] » du collectif Redstockings 1969.
L’agrégation et la conversion de ces ressentis est ici essentielle : il ne suffit pas d’exprimer son malheur ou son désespoir, il faut le faire en commun. Effectivement, là où nommer sa douleur personnelle est insuffisant et peut facilement être intégré dans les programmes narcissiques de la culture néo-libérale et thérapeutique (le traitement médiatique de l’écoanxiété en atteste), les cercles féministes offrent, dans les mots de Hooks, un « site de conversion
[11] ». L’éventuelle mise en scène publique de ces émotions (l’action au Pentagone se basait par exemple sur plusieurs étapes, chacune représentant une émotion précise (peur, deuil, colère, etc.) parachève cette construction collective de puissance d’agir qui puise sa force dans un retournement du stigmate émotionnel.
Tandis que les affects sont souvent reliés au fait de subir ce dont on n’est pas l’acteur (passion -> pathos -> subir), ces exemples nous montrent que les passions tristes sont source de puissance d’agir. En ce qu’il est impossible de déterminer la nature bonne ou mauvaise, joyeuse ou triste, d’un affect per se, il nous faut passer d’une pensée des affects à une pensée des arrangement affectifs. Tout dépend de la mise en forme, du contexte d’énonciation, et surtout, de l’aspect collectif ou non de cet affect.
Reconnaître notre « peine pour le monde » (Macy) permet de rendre compte plus justement de l’état du monde, et ensuite de se relier différemment. On peut rester frustré·e : ces micropolitiques ne sont pas suffisantes, et ne stopperont ni le capitalisme fossile, ni la montée des inégalités. Elles font toutefois partie d’un éventail de tactiques plus large, et contrent les sentiments d’impuissance, ainsi que la tendance à se percevoir comme une entité autonome déconnectée des autres vivants. Elles montrent une manière alternative d’être affecté‧e par le monde, et d’en faire partie.
3. Politiques du souci
Les exemples cités participent moins d’une politique de l’affect que d’une politique de l’être affecté‧e. Là où ce qu’on appelle des « démagogues » cherchent à attiser les peurs des autres, les femmes des exemples cités revendiquent, partagent et mettent en scène leurs propres émotions. Apparaît ici une distinction entre politique de la peur des tyrans qu’il nous faut rejeter et de la politique du souci des « catastrophistes » qu’il nous faut embrasser. Là où le tyran ne dira jamais sa peur mais intensifie les peurs des autres, le catastrophiste revendique et partage ses peurs. Le tyran se présente comme une personne dotée de capacités hors du commun, tandis que le catastrophiste se présente comme être vulnérable et émotionnel, dans l’espace public. Le tyran dénonce un bouc émissaire dont l’éradication (ou exclusion) fera cesser les peurs ; le catastrophiste désigne et identifie des adversaires politiques qu’il estime être à l’origine de ses peurs.
En cette époque des passions tristes, nous avons intérêt à relire tout un corpus de travaux féministes - qui a théorisé depuis longtemps l’ambivalence fondamentale des affects - en tant qu’ils sont toujours à la fois potentiellement un instrument de domination et une base pour l’émancipation. Loin de se contenter d’une contemplation cynique des souffrances de ce monde, certaines communautés émotionnelles de peur, de deuil et de colère, qui naissent des cendres de l’espoir progressiste, sont la preuve vivante que les « passions tristes » de l’écologie peuvent être piliers d’une puissance d’agir retrouvée (agency). À rebours des conceptions rationalistes et viriles du politique et de leurs dichotomies, ces exemples nous permettent d’esquisser un sujet politique subissant et agissant, émotionnel et rationnel, (inter)dépendant et émancipé.
Léna Silberzahn est doctorante en théorie politique à Sciences Po. À la croisée des humanités environnementales, des affect studies et des études de genre, son travail de thèse porte sur les agencements affectifs engendrés par les mutations écologiques. Titulaire d’une licence de droit et d’un master de recherche en théorie politique, Léna enseigne à Sciences Po et à l’Université de Nanterre.
Synthèse rédigée par Loïs Mallet
Références
[1] G. Albrecht,
Les émotions de la Terre: des nouveaux mots pour un nouveau monde, C. Smith (trad.), Paris, les Liens qui libèrent, 2020
[2] R. Gifford, « The Dragons of Inaction: Psychological Barriers That Limit Climate Change Mitigation and Adaptation »,
American Psychologist - AMER PSYCHOL, vol. 66, 1
er mai 2011, p. 290-302 ; A. Leiserowitz, « Climate Change Risk Perception and Policy Preferences: The Role of Affect, Imagery, and Values »,
Climatic Change, vol. 77, n
o 1, 1
er juillet 2006, p. 45-72
[3] F. Lordon,
Les affects de la politique, Paris, Seuil, 2016
[4] F. Neyrat, « Biopolitique des catastrophes »,
Multitudes, no 24, n
o 1, Association Multitudes, 2006, p. 107-117
[5] R. Riesel et J. Semprun,
Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, Paris, Édde l’Encyclopédie des nuisances, 2008
[6] H. Jonas,
Le principe de responsabilité : Une éthique pour la civilisation technologique, J. Greisch (trad.), Paris, Flammarion, 2013
[7] G. Anders,
L’obsolescence de l’homme : Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, C. David (trad.), 1
re éd., Paris, L’Encyclopédie des Nuisances, 2002
[8] S. Ahmed,
The promise of happiness, Durham, NC London, Duke University Press, 2010
[9] L. Berlant,
Cruel optimism, Durham, Duke University Press, 2011
[10] C. Hanisch, « The Personal Is Political »,
Notes from the Second Year: Women’s Liberation, 1970, p. 5
[11] B. Hooks,
Feminism is for Everybody: Passionate Politics, s. l., Pluto Press, 2000